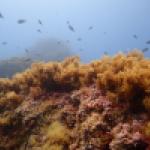Source des données
Les poissons associés à l’herbier de posidonie occupent différentes positions dans cet habitat et leur présence est variable en fonction des étapes de leur cycle de vie. Les abondances et les biomasses des différentes espèces de poissons sont également fluctuantes en fonction de la profondeur, de la saison et de l’année. Ces derniers participent activement au fonctionnement de l’écosystème. La richesse spécifique, l’abondance et la biomasse sont favorisées par les écotones, c’est-à-dire les zones de transition d’un habitat à l’autre, comme les roches ou le sable dans les herbiers. Les poissons sont généralement estimés par comptages visuels, entre 10:00 et 16:00 durant l’été ou l’automne de préférence sur de l’herbier continu (p. ex. assez distant des habitats à substrats durs).
Protocole de récolte
Tous les poissons, par espèce, sont dénombrés et leurs tailles évaluées sur 10 transects de 50 m de longueur et 2 m de large. Chaque transect couvre donc une surface de 100 m2 et la totalité des transects une surface de 1 000 m². Pour chaque individu, la taille est évaluée à 2 cm près jusqu’à une taille de 30 cm, puis à 5 cm près pour une taille comprise entre 30 et 100 cm et enfin à 20 cm près au-delà de 100 cm. Les données récoltées vont permettre de calculer la biomasse humide des poissons prédateurs d’invertébrés (compartiment 10), des prédateurs piscivores (compartiment 11) et des planctonophages (compartiment 12) (cf. Tableau 5 ; Ruitton et al. 2017). Pour les planctonophages, 2 catégories d’espèces sont distinguées ; (i) les consommateurs exclusifs de zooplancton et (ii) les omnivores qui consomment à la fois du zooplancton et de la matière particulaire en suspension. La moyenne des deux sous indices (p. ex. biomasse des zooplanctonophages et la biomasse des omnivores planctonophages) permet de calculer l’indice final du compartiment 12. A noter que certains prédateurs sont actifs uniquement la nuit alors que d’autres sont actifs le jour et se retrouvent donc plus présents dans les comptages visuels. D’autres prédateurs sont cachés dans l’herbier durant la journée. Ainsi les comptages effectués sous-estiment généralement le peuplement de poissons, cependant les échelles pour calculer le statut des compartiments biologiques tiennent compte de ces biais. Enfin, pour l’ensemble des espèces de poissons un indice spécifique de diversité relative (SRDI) est calculé. Il correspond au nombre moyen d’espèces par transect (moyenne du nombre d’espèces dans chaque transect).
Les comptages visuels de poissons consistent à noter tous les poissons rencontrés dans le transect (50 m de long sur 2 m de large) et d’évaluer simultanément leur taille. Le transect est déroulé sur le fond simultanément au comptage. Afin d’observer le mieux possible les poissons, le plongeur doit se déplacer lentement au ras de feuille de l’herbier afin d’avoir une vision horizontale juste au-dessus de l’herbier et pourvoir également regarder entre les feuilles. C’est pour cela d’ailleurs que la largeur du transect est étroite (2 m). Généralement, il faut environ 8 min pour effectuer le comptage sur 1 transect. Il est conseillé de préparer à l’avance des fiches de terrain avec une liste des poissons préétablie.
Lors du comptage de poissons, le pentadécamètre est déroulé par le plongeur qui effectue le recensement. Afin de limiter les manipulations de déroulement et de ré-enroulement du pentadécamètre, il est possible d’effectuer 3 comptages de poissons sur un pentadécamètre déroulé : 1 au niveau du pentadécamètre, un à gauche lors du retour puis un à droite lors d’un nouveau passage. Ces 3 recensements sont parallèles entre eux et à une distance permettant de garder à vue le pentadécamètre mais suffisante pour ne pas perturber les comptages par le passage répété du plongeur. Cette distance dépend de la visibilité et doit être au minimum de 5 m.

Figure 1 : Comptage de poissons sur l’herbier de posidonie et stratégie d’optimisation de l’échantillonnage (Ruitton et al. 2017).